La Révolution de 1789, le Directoire, le Consulat et l'Empire
Avec la Révolution, les structures économiques, politiques et sociales vont être transformées en profondeur. Les cahiers de doléance de la paroisse n'ont pas été conservés. On sait que les habitants se plaignent des impôts élevés ainsi que de l'isolement dont souffre la paroisse (mauvais chemins, la rivière Drot n'était pas navigable...).
Le 1er août 1789 : « Tous les habitants de la paroisse de Dieulivol sans distinction de rang ni d’état, formant la commune de ce canton (…) toujours guidés par les sentiments de patriotisme qui les dirige, ayant considéré que dans ces circonstances alarmantes où les propriétés et la sûreté publique sont en proye au brigandage, l’esprit de sédition et de désordre qui voudrait percer à la faveur des révolutions présanctes ne pouvaient être garanties et conservées avec quelque avantage que par une réunion prompte à une concorde fraternellement établie par tous les vrais citoyens fidèles à leur roy et aux intérêts précieux de la Nation ont arrêté unanimement que pour prévenir toute incurtion menaçante, tout acte de violence contraire au bien public, toute attaque faite aux propriétés et à la liberté de chaque individu, toute entreprise nuisible aux lois de la société, enfin tout excès qui pourrait être commis par des brigands de tout état, de tout rang (…) il sera levé sur le champs sous le bon plaisir et l’autorité du monarque qui nous gouverne et à l’exemple de la ville de Paris (…) et particulièrement d’après les précautions de sagesse qu’a prise la capitale de cette province [Bordeaux] à laquelle le canton de Dieulivol s’empressera toujours de donner des preuves de dévouement et d’union dans tous les cas, des troupes citoyennes et patriotiques auxquelles seront confiées le soin de défendre, protéger et conserver sur leur honneur et confiance les lois sociales, les propriétés sacrées et l’ordre public pour la liberté et sûreté personnelle de chaque citoyen (…) »
En février 1790 le premier conseil général de la commune de Dieulivol est constitué. Il se compose du corps municipal élu par les citoyens actifs qui comprend 5 officiers municipaux - Andrieu, Chadelle, Castenet, Lauriol, Blanchet - et Antoine Berthonneau qui est élu maire. Mestrot procureur syndic élu est chargé de défendre les intérêts de la commune. Jean Bignon est secrétaire-greffier. Les 12 notables désignés par l'élection pour compléter la composition de ce conseil général de la commune sont : Jean Guilherie (des Janins), Soulier (du bourg), Guillaume Daynaud, Jean Clary jeune, Jean Portier, Raymond Blanchet, Ouvrard, Simon Pellet, Jean Richier, Mathurin Mestrot, Avril et Charrier.
En juin 1793 Dieulivol se rallie à la commission populaire de Bordeaux et apporte son soutien à l'insurrection des Girondins. Accusé de «fédéralisme» et de «trahison» le maire de Dieulivol Antoine Berthonneau est inquiété. Son fils, André-Jacques Berthonneau, avocat, administrateur du district de La Réole est lui aussi poursuivi. Il se donne la mort le 30 octobre 1793 (9 brumaire an II) alors qu’un détachement de cavalerie est lancé à sa poursuite. Son corps est ramené à Bordeaux et sa dépouille conduite sur l’échafaud. Profondément affecté par la disparition de son fils, Antoine Berthonneau s’éteint dans sa maison au bourg de Dieulivol le 19 mars 1797 (29 ventôse an V) à l’âge de 66 ans.
.Le curé Louis Paulin du Barry de La Barthe a quant à lui prêté le serment civique dès le 16 janvier 1791. Pourtant en 1794 le comité de surveillance de Monségur s’en prend à celui que tout le monde appelle désormais Dubarry. Malgré son grand âge le curé est arrêté le 7 août 1794 (20 thermidor an II) et il reste détenu jusqu’au 23 août avant d’être remis en liberté par le représentant en mission Joseph Lakanal.
Le 15 juillet 1794, le même Lakanal prend par arrêté la décision de rendre la rivière Drot navigable.
Lors de la vente des biens nationaux le notaire Jean Bouilhac se porte acquéreur du moulin de Gallaud.
En 1804 le premier consul Napoléon est proclamé empereur. Au même moment le maire de Dieulivol François Andrieu et les membres du conseil de fabrique s’opposent aux travaux de réfection de l’église. C’est néanmoins au cours de cette période, et sur proposition du maire, que sont exécutés les travaux de rehaussement des murs de la nef. Plusieurs Dieulivolais participent aux campagnes militaires de l'Empire.
Barthélémy Beausoleil maire durant les Cent Jours est reconduit dans ses fonctions sous la Restauration puis sous la Monarchie de Juillet. Après son décès c’est son adjoint Nicolas Benjamin Guerre qui lui succède le 13 décembre 1835. En septembre 1846 Pierre Eugène Lauga devient maire à son tour. Il est lui même remplacé par son fils Pierre Emile Lauga en 1864.
 |
Tombeau
de la famille Lauga dans le cimetière de Dieulivol
(photographie Benoît Pénicaud)
Une personnalité emblématique du Second Empire à Dieulivol : Fabien Guerre
Sous la IIIe République, quelques semaines après les obsèques du maire de Dieulivol André Grenouilleau, au mois de juin 1898, son petit-fils André Pellet devient adjoint du nouveau maire Jean Rambaud. Il sera élu maire à son tour en mai 1910.
En octobre 1899 le chemin de fer arrive à Dieulivol avec l'ouverture d’une gare et la livraison de la ligne La Sauve-Eymet. La commune est ainsi reliée à la gare de Bordeaux-Bastide.
 |
(Collection Benoît Pénicaud)
En 1905 commencent les travaux du pont de Gallaud dont la construction permet le franchissement du Drot. Une route reliant le pont à la gare est également construite. Les travaux sont définitivement achevés en 1908.
La déflagration provoquée par la Grande Guerre de 1914-1918 provoque de profonds traumatismes et a de graves conséquences démographiques pour la commune. Dès la fin du conflit les soldats survivants décident de planter un chêne à proximité de l'église "afin de rappeler aux générations futures le devoir de prier pour les enfants de Dieulivol morts pour la France".
Dans les années 1920 des familles issues de l'immigration espagnole et italienne se fixent dans la commune. Ces Espagnols et ces Italiens parviennent à s'assimiler rapidement. Ils sont d'abord fermiers ou métayers puis ils deviennent propriétaires de petites exploitations agricoles. Au même moment des Bretons et des Périgourdins s'installent aussi à Dieulivol.
En 1924 la municipalité obtient l’établissement d’une ligne téléphonique pour la commune puis, l’année suivante, la création d’une agence postale.
Le monument aux morts de la Première Guerre Mondiale, dont la réalisation avait été confiée à l'architecte Barbe de Saint-Ferme, est officiellement inauguré le 22 mars 1925. Le début des années 1930 coïncide avec le début de l’électrification de la commune. La construction de la mairie et de l’école intervient en 1935-1936.
 |
La mairie et le monument aux morts
(photographie Benoît Pénicaud)
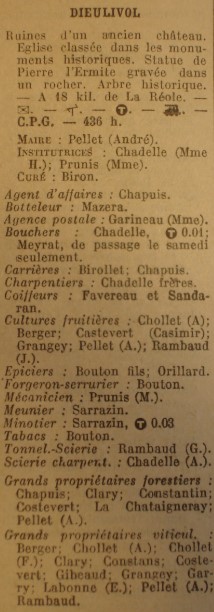 |
Le 2 septembre 1939 un télégramme parvenait à la mairie de Dieulivol : le ministre de la guerre portait à la connaissance du maire l’ordre de mobilisation générale décrété le jour même. Le lendemain la France déclarait la guerre à l’Allemagne nazie.
Devant la menace d’une invasion imminente du territoire, des habitants du département de Meurthe-et-Moselle évacuèrent massivement villes et villages. Assez vite des réfugiés de tout l'Est de la France, et notamment de Villerupt et de Longwy, arrivent dans la commune où il faut organiser leur accueil et leur procurer un hébergement.
Après la débâcle et la défaite de juin 1940 Dieulivol reste en zone libre. La commune est rattachée au département voisin du Lot-et-Garonne par arrêtés préfectoraux des 15 et 16 novembre 1940 et elle passe sous l'administration de la sous-préfecture de Marmande.
Au cours de l’été 1942 le curé de Dieulivol, un jeune prêtre originaire du Nord de la France, arrivé en 1940, aménage avec les habitants une cavité naturelle située en contrebas de l’église pour la transformer en sanctuaire marial. Le 15 août a lieu une cérémonie dédiant la grotte de Dieulivol à la Vierge.
 |
La grotte dédiée à la Vierge "Diex Li Volt" (collection Benoît Pénicaud)
L’année suivante, le 8 août 1943, ce sont près de 5000 fidèles qui affluent à Dieulivol pour une « journée nationale de croisade mariale» à l’occasion du départ de la statue de Notre Dame de Boulogne sur la voie du grand retour. Cette manifestation satisfait pleinement les catholiques partisans du maréchal Pétain et du régime de Vichy. André Pellet, maire de Dieulivol, dans son discours devant les autorités « expose la situation politique et sociale de la commune et souligne l’épanouissement des divers groupements et cette union totale entre ses administrés que désire tant le gouvernement et qu’exalte l’église ».
 |
en présence de l'archevêque de Bordeaux Monseigneur Feltin, du curé Desmazières, du sous-préfet de Marmande,
du capitaine de la Gendarmerie de La Réole, des membre du conseil municipal et de la presse.
(Collection Benoît Pénicaud)
Ces années là sont marquées par des conditions de vie souvent difficiles où se mêlent privations, trafics et marché noir, franchissements clandestins de la ligne de démarcation, actions de résistance, exactions commises par l'occupant et par la Milice…
Un fait marquant se produit pour les habitants : le 5 mars 1944 un bombardier américain B-24 Liberator l'Aphrodite's Disciples est abattu par les Allemands. L'appareil s'écrase dans la commune, dans une parcelle de terre située entre les lieux-dits "Castevert" et "Les Bretons" après que les membres de l’équipage aient pu s’en extirper ! Le pilote traverse le Drot à la nage mais il est livré à la Gendarmerie par un habitant de Monségur. Les gendarmes se voient contraints de le remettre aux Allemands. Il sera finalement envoyé en captivité. Les autres membres de l'équipage parviennent à s'enfuir et à quitter le pays avec l'aide de la Résistance à l'exception de l'un d'entre eux qui périra sous les balles de l'occupant.
 |
 |
de la 1ere moitié du XXe siècle
(collection Benoît Pénicaud)
André Pellet, (1873-1950), conservateur, catholique, maire de Dieulivol à partir de 1910. Mobilisé le 14 août 1914, il prend part à la Première Guerre Mondiale. Dans l’entre-deux-guerres il œuvre pour la modernisation de la commune. Après la victoire du Front Populaire aux élections législatives de 1936 et l'élection du radical-socialiste René Thorp dans la circonscription de La Réole, André Pellet est désigné pour représenter la très conservatrice U.R.D. (Union Républicaine Démocratique) pour l'élection au Conseil général l'année suivante. Il est élu au premier tour le 10 octobre 1937. La presse de droite avait fait campagne en sa faveur notamment Le Rappel Girondin, organe de l'Alliance démocratique, dans son édition du 18 septembre 1937, ou encore Le Flambeau du Sud-Ouest du 7 octobre 1937 organe du PSF (Parti Social Français). La Petite Gironde du 28 septembre 1937 vantait «son dévouement désintéressé, sa probité mais aussi ses hautes qualités d’administrateur. […] Patriote convaincu, partisan de l’ordre et de la paix il sera le défenseur ardent des institutions républicaines » Après juin 1940 il est maintenu dans ses fonctions de maire et nommé conseiller départemental par le gouvernement de Vichy. Après la Libération, en novembre 1944, il préfère démissionner de son mandat de maire. Une délégation spéciale municipale est alors nommée pour administrer la commune. Une note du Comité Départemental de Libération datée du 8 janvier 1945 indique qu’il était « partisan de l’ordre nouveau » et qu’il «manifestait un loyalisme certain vis-à-vis du gouvernement du maréchal dont il approuvait la politique de redressement ». André Pellet jouissait néanmoins d’une « présomption favorable» le «mettant a priori à l’abri de la déchéance prévue par le texte » en sa qualité de conseiller général précédemment élu, comme le rappelait le ministre de l'Intérieur dans un courrier daté du 27 janvier 1945. Il fut élu dès le 1er tour des élections municipales du 29 avril 1945 et il retrouva son fauteuil de maire. Il brigua finalement, et obtint, un nouveau mandat de conseiller général lors des élections cantonales des 23 et 30 septembre 1945. André Pellet s’éteignit le 21 novembre 1950 à l’âge de 77 ans. La presse régionale rendit hommage à cet homme affable, doté de compétences remarquables en matière d’administration. Avec lui disparaissait « une vieille figure de la vie politique girondine » qui laissait l’image d’un homme plutôt modéré « et parfaitement mesuré quant à l’orientation politique »… Une leçon sans doute apprise de sa longue l’expérience.
Tout au long du XXe siècle Dieulivol poursuivit sa traversée des soubresauts de l'Histoire en se singularisant, par un profond conservatisme politique, la commune connaissant, tour à tour, la prospérité de ses vignobles, l'exode rural et le déclin du monde paysan.
Les maires de Dieulivol depuis 1790
Antoine Berthonneau 1790-1791
Pierre Chadelle (de Martineau) 1791-1792
Antoine Berthonneau 1792-1795
Entre l'an III et l'an VIII (1795-1800) Dieulivol intègre la municipalité du canton de Saint-Ferme. La commune est représentée par un agent municipal, fonction successivement occupée par Ferchaud puis François Andrieu.
François Andrieu 1800-1806
Jean Roullet 1806-1815
Barthélémy Beausoleil 1815-1835
Nicolas Benjamin Guerre 1835-1846
Pierre Eugène Lauga 1846-1864
Pierre Emile Lauga 1864-1878
André Grenouilleau 1878-1898
Jean Rambaud 1898-1910
André Pellet 1910-1945
Gérard Chadelle 1945 (févr.-mai, délégation spéciale municipale)
André Pellet 1945-1950
Jacques Goulard 1950-1964
Jean-Jacques Goulard 1964-2013
Bernard Dalla Longa 2013-
Benoît Pénicaud - L'Histoire de Dieulivol